Stephan MICUS
Aux sources du silence

Dans les années 1960, les hippies s’intéressèrent à l’Inde, qui, du point de vue d’une jeunesse avide de faire tomber les limites du système capitalo-patriarcal, représentait une civilisation fondée sur le spirituel. Le mélange d’une vision romantique de l’Inde avec les produits lysergiques ne permit pas d’étoffer cette première approche au-delà des quelques incursions sitaristiques de George HARRISON. Elle fit en revanche connaître au monde occidental le déjà légendaire (en Inde) à son époque, maître de sitar de l’ex-BEATLES : Ravi SHANKAR. On peut dire qu’il fut le premier pont entre le grand public occidental et une culture non-occidentale, ainsi qu’une révélation pour Stephan MICUS.
Les années 1970 furent du point de vue de la « world music » un désert ; excepté le reggae, les autres genres musicaux étaient strictement réservés à leur public respectif, géographiquement ou culturellement parlant. Il fallut attendre le début des années 1990, particulièrement grâce au label de Peter GABRIEL, Womad, pour trouver des artistes non occidentaux s’adressant à un large public blanc et ce au-delà d’un simple coup publicitaire (style Soul Makossa de Manu DIBANGO) ou d’un effet de mode.
Entre ces deux décennies, le terrain des rencontres culturelles et des voyages musicaux n’étaient à bien regarder pas si totalement vide que ça. Car un électron libre du « baba-coolisme » sévissait déjà dès 1976 dans cette zone. Par ailleurs, Stephan MICUS, puisqu’il s’agissait de lui, avec ses silences, ses sons purs et ses ambiances quasi-médiévales, anticipait avec quinze ans d’avance le new-age acoustique. MICUS proposant une musique d’une trop grande qualité, d’une trop grande profondeur, trop en avance sur son temps, son destin mit du temps pour croiser les appétits d’un public avide de sensations frelatées.
Depuis Athos en 1994, il est l’un des piliers commerciaux de ce prestigieux label allemand, ECM. L’histoire de la rencontre de Stephan MICUS et du label de Manfred EICHER remonte pourtant déjà à 1977. Sa liberté musicale y est totale tant il est vrai que MICUS est emblématique du son de la marque ECM : « le plus beau son après le silence ». Plus que ça : à eux deux, le producteur et le musicien incarnent au plein sens du terme, l' »autre » idée de l’Allemagne loin de BEETHOVEN et WAGNER, loin de la choucroute et de la bière, à l’opposé du IIIe Reich. C’est celle d’une Allemagne introvertie, sensible et silencieuse, l’Allemagne de Herman HESSE, de Thomas MANN, de Wim WENDERS ou de NOVALIS. Son passage en France, fin 2003, motive amplement l’article que nous lui consacrons tant il est vrai que l’homme ne souscrit que peu aux mots d’ordre de notre époque : médiatisation et communication.
Rétrospective discographique
Implosions (1977-ECM)
 Ce premier album de Stephan MICUS signé sur ECM (NDLR: il y en a eu un autre auparavant, Archaic Concerts, paru sur Carline Records mais jamais réédité en CD) mérite bien son nom. Car en cette année 1977, c’est par contraste l’explosion punk, dans le secteur rock, et l’année suivante l’explosion disco chez le grand public. L’éclate à tout va, le culte de la personnalité et du bien-être d’un ego tout-puissant est l’inverse même de la musique de MICUS, où le recueillement, l’effacement de soi domine. Cette musique érémitique voudrait faire rentrer dans votre salon les traditions d’autres pays : l’Inde avec As I Crossed a Bridge of Dreams, le Japon avec le shakuhachi de Amarchaj, l’Asie du Sud-Est avec For the Beautiful Changing Child (titre plus baba tu meurs !), l’Orient avec For M’schr and Djingis Khan.
Ce premier album de Stephan MICUS signé sur ECM (NDLR: il y en a eu un autre auparavant, Archaic Concerts, paru sur Carline Records mais jamais réédité en CD) mérite bien son nom. Car en cette année 1977, c’est par contraste l’explosion punk, dans le secteur rock, et l’année suivante l’explosion disco chez le grand public. L’éclate à tout va, le culte de la personnalité et du bien-être d’un ego tout-puissant est l’inverse même de la musique de MICUS, où le recueillement, l’effacement de soi domine. Cette musique érémitique voudrait faire rentrer dans votre salon les traditions d’autres pays : l’Inde avec As I Crossed a Bridge of Dreams, le Japon avec le shakuhachi de Amarchaj, l’Asie du Sud-Est avec For the Beautiful Changing Child (titre plus baba tu meurs !), l’Orient avec For M’schr and Djingis Khan.
Néanmoins, Stephan MICUS n’essaye à aucun moment de reproduire stricto sensu les musiques de ces différentes traditions, mais le fait qu’il se soit donné la peine d’apprendre à jouer (souvent sur place) de chaque instrument relevant d’horizons si divers et si éloignés (citons en vrac le sho, la flûte thaï, le rabab et le sitar) en dit long sur le respect qu’il leur porte, et aussi sur sa motivation en tant que musicien.
Sur un plan plus formel l’album, ambitieux à sa base, est un peu gâté par des vocaux pas très convaincants. Stephan MICUS chante une choucroute (c’est-à-dire des syllabes ou des onomatopées dépourvues de sens) qui aurait la prétention de se rapprocher d’un néo-language orientalo-hindouisant. Notre Allemand n’a hélas pas le privilège, comme MAGMA et sa langue kobaïenne, de se situer dans un contexte mythologico-SF. Au contraire voulant remonter aux sources (à la source de l’être, le silence), il décide d’œuvrer dans le réel, de se poser, et non de naviguer dans le délire. Cette épine dans l’œuvre de MICUS ne sera enlevée qu’en 1994 où avec Athos il chantera en anglais, idem dans Desert Poems en 2001.
En 1997 avec The Garden of Mirrors, sa choucroute, africanisante, aura été contre toute attente frappée par la grâce. Mais en 1977, Implosions, qui a tout en apparence d’un grand classique, se transforme hélas en album intéressant (c’est-à-dire écoutable en fond sonore) par la disgrâce de ses vocaux.
Till the End of Time (1978-ECM)
 Attention… Chef-d’œuvre !! Sur cet album, Stephan MICUS se recentre sur l’Europe, mais une Europe médiévale (en est responsable principalement l’utilisation du kortholt – ou courtaud -, une sorte de basson, mais également les accords utilisés), et réduit à deux titres de 18 minutes le champ de son horizon temporel et géographique (For Wis and Ramin, tout en collant à l’atmosphère de recueillement médiéval de l’album, prend plutôt ses sources dans une Andalousie musulmane).
Attention… Chef-d’œuvre !! Sur cet album, Stephan MICUS se recentre sur l’Europe, mais une Europe médiévale (en est responsable principalement l’utilisation du kortholt – ou courtaud -, une sorte de basson, mais également les accords utilisés), et réduit à deux titres de 18 minutes le champ de son horizon temporel et géographique (For Wis and Ramin, tout en collant à l’atmosphère de recueillement médiéval de l’album, prend plutôt ses sources dans une Andalousie musulmane).
Cette perte de la diversité des instruments (la guitare en étant le pivot) s’accompagne d’un accroissement brusque de la qualité et de l’intensité du discours musical. L’homme vibre à n’en pas douter, et cette vibration vient de très loin ; à l’apparition du kortholt la partie finale du titre éponyme de l’album, cette vibration se transforme carrément en vision. Ce n’est plus de la musique, c’est de l’alchimie. Le son est évidemment ciselé comme une orfèvrerie par Manfred EICHER, mais l’ensemble sonne encore plus cristallin, encore plus silencieux que sur les productions habituelles du label. Les vocaux, le point faible de MICUS, sur le deuxième titre, passent in-extremis (à moins que la surabondance de grâce anihile ici l’incongruité intrinsèque de la choucroute micusienne).
Il y a « réellement » dans cet album quelque chose de l’ordre de la transcendance. On plane ici à des hauteurs que je croyais uniquement réservées aux synthés. Formellement, on pense bien sûr à un autre ermite multi-instrumentiste, Mike OLDFIELD, mais qui œuvre dans la sphère du rock progressif (et qui hélas décida en 1978 de suivre une psychanalyse qui mit fin à sa production progressive pour le jeter dans la variété rock). Ce serait un Mike OLDFIELD qui ne jouerait que les parties les plus calmes de Hergest Ridge ou Ommadawn mais passées en 16 tours (pour les plus jeunes d’entre nos lecteurs, je précise qu’en 1978 le disque vinyle tourne à 33 tours/minute), mais avec la qualité sonore d’un orchestre de chambre. Un Mike OLDFIELD apaisé, habité par une énorme tension mystique.
Behind Eleven Deserts (1978-Intuition Records)
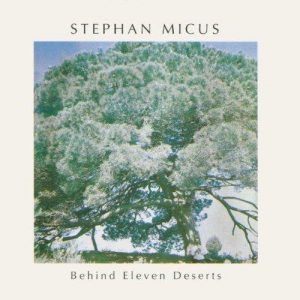 Cet album, le seul signé hors du label ECM, fait difficilement suite à son prestigieux prédécesseur. Le changement de maison de disques n’a entre autres pas affecté la musique de Stephan MICUS, qui navigue comme à l’accoutumée entre les ambiances arabo-andalouses, le médievalisme et le celtisme, le tout agrémenté d’une touche indienne (The Song of Danijar est joué au sitar).
Cet album, le seul signé hors du label ECM, fait difficilement suite à son prestigieux prédécesseur. Le changement de maison de disques n’a entre autres pas affecté la musique de Stephan MICUS, qui navigue comme à l’accoutumée entre les ambiances arabo-andalouses, le médievalisme et le celtisme, le tout agrémenté d’une touche indienne (The Song of Danijar est joué au sitar).
On perçoit ici quelques éléments comme les accents africains des mélopées ou le suling (une flûte balinaise) qui ne seront repris et pleinement exploités que bien plus tard dans les années 1990. D’autres en revanche seront définitivement abandonnés comme le sitar, instrument emblématique du hippisme au tournant des 70’s, ou un certain celtisme (dommage d’ailleurs, car le très rafraichissant I Went on Your Wing, joué avec quatre tin whistles, ces flûtes aiguës irlandaises, sur fond de guitare folk, constitue de très loin le moment le plus marquant de l’album).
Les voix, sur trois titres, constituent toujours l’élément le plus faible de cet œuvre, à tel point que sur le titre éponyme de l’album aux relents maghrébo-africains, je ne suis pas sûr de la justesse de son chant. Sinon, la touche japonaise est également présente avec Katut, où le sarangi (un hybride indien du violon et du sitar) normalement archeté, fait office de koto, en étant pincé. Over Crimson Stones nous emmène dans une atmosphère provençale qui ne dépare pas de l’ambiance globalement arabo-andalouse de l’album.
En résumé, l’album est tout à fait écoutable sans pour autant titiller outre-mesure la trompe d’Eustache de l’auditeur, avec (hélas) une « plantade » complète (le titre éponyme) et un joyau (I Went on Your Wings) qui mérite à lui seul qu’on achète ce disque.
Koan (1981-ECM)
 Chronologiquement postérieur dans la discographie au superbe Till the End of Time, il lui est en fait antérieur quant à la date de l’enregistrement (1977, c’est-à-dire l’année où fut enregistré Implosions). Et cela se sent : la force de Till the End of Time n’habite pas encore ce Koan certes élégant et somme toute compact et cohérent. Tout l’inverse d’Implosions qui, en voulant explorer trop d’horizons différents, n’arrivait à propulser l’auditeur dans aucun.
Chronologiquement postérieur dans la discographie au superbe Till the End of Time, il lui est en fait antérieur quant à la date de l’enregistrement (1977, c’est-à-dire l’année où fut enregistré Implosions). Et cela se sent : la force de Till the End of Time n’habite pas encore ce Koan certes élégant et somme toute compact et cohérent. Tout l’inverse d’Implosions qui, en voulant explorer trop d’horizons différents, n’arrivait à propulser l’auditeur dans aucun.
Koan se centre évidemment sur le Japon. Le Japon fondamentalement évoqué tout au long de l’œuvre de Stephan MICUS (le Japon du bouddhisme zen, du silence intérieur, et des rituels hiératiques tels que le tir à l’arc ou la cérémonie du thé), l’est ici de manière formelle avec la quasi omniprésence du shakuhachi. Les vocaux sur la Part IV se font fragiles et authentiques, et sur la Part III b, MICUS s’excite, chose exceptionnelle dans sa discographie.
Sur les quatre autres titres, le niveau d’inspiration et la qualité technique sont élevés, sans toutefois atteindre l’excellence. On devine en filigrane la grâce qui touchera les albums à venir (la Part V annonce à elle seule l’album Ocean de 1986, un de ses futurs classiques). Le Koan, cette énigme que le moine zen doit méditer pour parvenir à l’illumination, sied en fait assez mal en tant que titre à cet album peu énigmatique (Stephan MICUS, qui utilise quasiment toujours une gamme de sol mineur, ne l’est musicalement jamais), et qui contient le seul titre nerveux d’une discographie dédiée à la contemplation (la pochette est également, hélas, en contre-emploi).
Néanmoins, Koan, beaucoup plus que Till the End of Time, est emblématique de son style à la fois méditatif et japonisant.
Wings over Water (1982-ECM)
 Cet album a qualitativement beaucoup à voir avec Koan, dans la mesure où comme Koan annonce le futur classique que sera Ocean en 1986, Wings over Water annonce Twilight Fields en 1987. Par ailleurs, ces deux albums pour ainsi dire précurseurs sont tout à fait honorables (MICUS n’a d’ailleurs jamais pondu de mauvais album) et sont dignes de figurer dans une discothèque intelligente même si leur écoute ne sera certes pas intensive.
Cet album a qualitativement beaucoup à voir avec Koan, dans la mesure où comme Koan annonce le futur classique que sera Ocean en 1986, Wings over Water annonce Twilight Fields en 1987. Par ailleurs, ces deux albums pour ainsi dire précurseurs sont tout à fait honorables (MICUS n’a d’ailleurs jamais pondu de mauvais album) et sont dignes de figurer dans une discothèque intelligente même si leur écoute ne sera certes pas intensive.
Dans Wings over Water, notre Mike OLDFIELD allemand a décidé d’introduire à côté du nay (la flûte en roseau des dervishes turcs), du sarangi (un instrument à archet indien) et des guitares acoustiques, une nouveauté : les pots de fleurs. Remplis d’eau de manière à donner une note précise, ils sont utilisés comme instruments percussifs, et frappés avec des mailloches, donnant peu ou prou un son de xylophone mais en moins brillant.
Le premier titre de l’album est vaguement réminiscent d’un air de folk qui serait tiré du troisième album de LED ZEPPELIN mais joué avec le son METHENY et surplombé par du nay. Ce bon début est hélas gâché par le deuxième titre… chanté (cf. toutes les réserves émises quant à son chant dans les chroniques antérieures) détruisant la magie des pots de fleurs. Le feeling de la troisième partie est celui de Steve REICH, mais hélas privé de sa science musicale. La cinquième partie, après un solo de ney dispensable, contient une ligne mélodique simili orientale à la flûte un peu téléphonée (dommage, car ici les pots sont intéressants).
Quant à la sixième partie, ultra-micusienne en diable, après une intro arabo-andalouse à la guitare et un break à la cithare bavaroise, elle nous permet de découvrir le suling, une flûte balinaise haut perchée et purificatrice s’il en est, qui rattrape un peu les faiblesses du milieu de l’album.
Listen to the Rain (1983-ECM)
 Qualitativement, cet album surpasse son prédécesseur tout en lui ressemblant sur certains points. Comme Wings over Water, Listen to the Rain ouvre avec fraîcheur par un folk zeppelinien, mais dont la clarté sonore relèverait plutôt de Ralph TOWNER ou de Pat METHENY. Cette ouverture, qui mérite bien son nom (Dancing with the Morning), est magistralement surplomblée par la pureté des notes du suling, cette flûte balinaise.
Qualitativement, cet album surpasse son prédécesseur tout en lui ressemblant sur certains points. Comme Wings over Water, Listen to the Rain ouvre avec fraîcheur par un folk zeppelinien, mais dont la clarté sonore relèverait plutôt de Ralph TOWNER ou de Pat METHENY. Cette ouverture, qui mérite bien son nom (Dancing with the Morning), est magistralement surplomblée par la pureté des notes du suling, cette flûte balinaise.
Comme dans Wings over Water, les titres centraux, bons par ailleurs, témoignent d’une baisse qualitative par rapport à l’ouverture et au final. La guitare arabo-andalouse du titre donnant son nom à l’album n’amène rien de spécial. On se surprend ici à regretter la fulgurance des émotions qu’elle peut générer quand Stephan MICUS est habité par la grâce comme sur Till the End of Time. Ici, elle a un brin de je ne sais quoi de scolaire. White Paint on Silver Wood commence excellemment avec du shakuhachi. La tension mystique japonaise est hélas revue à la baisse par l’introduction d’une guitare arabo-andalouse, et le mélange hispano-nippon est loin d’être fascinant.
Heureusement, pour notre plus grand bonheur, le meilleur titre (le plus long : vingt minutes) clôt l’album et rattrape amplement cette baisse de régime. Il repose essentiellement sur le dilruba (une sorte de petit sitar archeté) et la guitare acoustique. Les dilrubas en question (l’artiste en joue jusqu’à cinq simultanément) rendent un son se situant plus bas que le violon, mais plus haut que le violoncelle. Ici ils renvoient à l’esprit médiéval de la vièle, et ce titre, For Abai and Togshan, n’aurait pas dépareillé sur Till the End of Time.
East of the Night (1985-ECM)
 Cet album voit continuer la maturation de l’artiste, qui est en voie de bonification constante, si on met de côté Till the End of Time, frappé par le sceau d’une grâce prématurée, comme extraordinaire. Avec sa passion pour le japonisme, qui a dû le conduire au Japon étudier le shakuhachi, on ne s’étonne pas du superbe For Nobuko, une Nipponne qui deviendra Madame MICUS.
Cet album voit continuer la maturation de l’artiste, qui est en voie de bonification constante, si on met de côté Till the End of Time, frappé par le sceau d’une grâce prématurée, comme extraordinaire. Avec sa passion pour le japonisme, qui a dû le conduire au Japon étudier le shakuhachi, on ne s’étonne pas du superbe For Nobuko, une Nipponne qui deviendra Madame MICUS.
East of the Night présente en ouverture un superbe titre où la guitare (une dix-cordes) rencontre la flûte japonaise. Mais contrairement à la surimposition un peu grossière d’une gamme arabo-andalouse et d’une gamme japonaise de l’album précédent, l’alchimie des deux instruments s’y fait de manière plus subtile ; une cohérence plus grande naît de l’effacement des traits les plus arabo-andalous, bien que quelques plans faciles de shakuhachi, transposés dans ces gammes, ne permettent pas à ce titre de gagner ses galons de chef-d’œuvre.
Tel n’est pas le cas du deuxième titre de l’album. Long comme le premier d’une vingtaine de minutes, il représente l’un des sommets de MICUS à la guitare. Ici une quatorze-cordes, spécialement fabriquée par Manuel DIAZ pour MICUS, permet à l’artiste de prouver sa force dans le dépouillement. Vingt minutes de guitare avec de grands silences, mais une telle intensité et un tel lyrisme dans les progressions mélodiques, permettent à l’attention de l’auditeur de ne jamais retomber.
Ici, nous avons atteint l’antipode de la guitare rock, de la guitare frime, des plans ressassés de MALMSTEEN, de RONDAT ou de VAI à 18 notes-seconde (nous sommes en 1985, c’est le début du shred et l’apparition des guitaristes néo-classico-métal à choucroute genre Vinnie MOORE, Greg HOWE, etc.). Et nous avons atteint le cœur de la guitare, le cœur de la beauté, soulevé par l’amour que MICUS porte à sa dulcinée.
Si les gens qui achetaient du new-age (1985, c’est aussi l’émergence en force de cette spiritualité composite et post-baba) avaient eu un tant soit peu de curiosité et de goût, MICUS aurait été depuis millionnaire. Mais c’est bien connu, l’élégance n’est pas le fort du grand public (surtout américain). C’est par l’écoute de cet album que j’ai personnellement pu oser me mettre à la guitare en essayant toujours de retenir la leçon de maître MICUS : la recherche de l’harmonie, du dépouillement, de l’essentiel qui l’emporte sur l’artifice et la technique.
Ocean (1986-ECM)
 Ocean est un classique de la discographie de Stephan MICUS. En renonçant à jouer de la guitare, considérant sans doute que sur son instrument il avait été aussi loin que possible dans l’album précédent, MICUS relève le challenge de s’appuyer sur le dulcimer frappé, une version américaine du santour. Ce challenge est tellement réussi qu’on oubliera à partir d’Ocean que Stephan MICUS est d’abord un guitariste. Il gagne ici réellement ses galons d’instrumentiste polyvalent, d’explorateur sonore sans concession.
Ocean est un classique de la discographie de Stephan MICUS. En renonçant à jouer de la guitare, considérant sans doute que sur son instrument il avait été aussi loin que possible dans l’album précédent, MICUS relève le challenge de s’appuyer sur le dulcimer frappé, une version américaine du santour. Ce challenge est tellement réussi qu’on oubliera à partir d’Ocean que Stephan MICUS est d’abord un guitariste. Il gagne ici réellement ses galons d’instrumentiste polyvalent, d’explorateur sonore sans concession.
Même si spirituellement on sent les influences orientales (voire moyen-orientales) et médiévales, il n’est plus possible de situer formellement la musique de MICUS. Le phénomène de fusion des cultures vient ici de s’opérer en profondeur dans la conscience de ce musicien, délaissant au loin les quelques superpositions naïves qui avaient pu, malheureusement, parsemer les albums précédents (hormis l’infaillible Till the End of Time).
Ocean renouvelle la grâce musicienne, moins chargée de pathos, plus légère, plus lumineuse. East of the Night était un album lourd de silence qu’on ne pouvait qu’écouter religieusement pour être pétri par son émotion, ou à l’inverse qu’on devait mettre en bruit de fond. Ici on échappe à ces deux extrêmes, car jamais la profondeur du propos n’empêche sa légèreté. (La Part II, la meilleure de l’album et l’un de ses plus beaux morceaux, fut jouée à Paris au Glaz’Art pour le Festival Octopus, le 12 décembre 2003.)
Stephan MICUS ne se trompe pas en pensant à Ocean comme pierre angulaire de son œuvre. Le chant, la partie la plus faible de MICUS, sur le titre d’ouverture, est frappé de cette grâce simple et pour une fois, sans être transcendant, ne gâche pas la musique.
Twilight Fields (1987-ECM)
 Sur ces « champs de l’aurore » la progression constante de Stephan MICUS continue. La nouvelle grâce insufflée sur l’album précédent se confirme ici, où comme par compensation pour le sacrifice de sa guitare, une brise divine semble planer sur tous les titres.
Sur ces « champs de l’aurore » la progression constante de Stephan MICUS continue. La nouvelle grâce insufflée sur l’album précédent se confirme ici, où comme par compensation pour le sacrifice de sa guitare, une brise divine semble planer sur tous les titres.
Le challenge ici est doublé par rapport à Ocean, puisque Stephan MICUS, changeant constamment d’angle d’attaque de sa musique, s’appuie sur les pots de fleurs. Le médiévalisme inhérent à la musique de l’artiste, qui s’était estompé sur Ocean, est ici tout à fait absent et c’est entre des rizières balinaises que l’auteur nous invite à nous promener d’un pas léger et émerveillé. C’est sans doute avec Till the End of Time et Darkness and Light l’album le plus fort, et aussi le plus ouvertement asiatique de Stephan MICUS (le shakuhachi soulignant ce dernier trait).
Que dire de plus sinon que ce chef-d’œuvre léger et profond doit absolument figurer dans toute discothèque digne de ce nom. Ma chronique en l’occurrence ne peut être que courte.
The Music of Stones (1989-ECM)
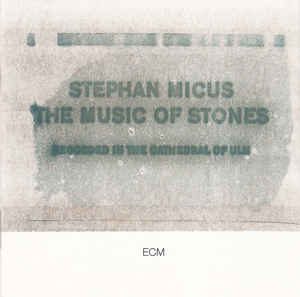 Cet album est le plus atypique de Stephan MICUS. L’artiste, d’habitude à la recherche d’horizons plutôt ethniques (par le biais de l’instrumentation et du jeu), livre ici un album qui glisse plutôt vers la musique contemporaine. L’idée de base, géniale s’il en est, est de jouer sur les sculptures de pierre d’Elmar DAUCHER, le tout enregistré dans la cathédrale d’Ulm.
Cet album est le plus atypique de Stephan MICUS. L’artiste, d’habitude à la recherche d’horizons plutôt ethniques (par le biais de l’instrumentation et du jeu), livre ici un album qui glisse plutôt vers la musique contemporaine. L’idée de base, géniale s’il en est, est de jouer sur les sculptures de pierre d’Elmar DAUCHER, le tout enregistré dans la cathédrale d’Ulm.
L’introduction magistrale au shakuhachi sur fond de pierre vibrante sonne tout comme du MICUS japonisant, d’autant plus que le son des sculptures se rapproche assez de celui des bols tibétains frottés. La suite, si elle est la plus aventureuse que MICUS ait créée, ne sera pas hélas moulée dans le même tonneau (en particulier le titre final assez proche du dodécaphonisme, avec pour ne pas arranger les choses un chant moins que convaincant).
Les sculptures en apparence assez imposantes sur les photos de la jaquette rendent certes un son cristallin et réverbéré, mais à la tonalité assez uniforme et assez serrée dans les aigus. Vu l’idée de base et les moyens déployés, le résultat n’est pas à la hauteur et la montagne accouche d’une souris.
Notons au passage sur cet album relativement décevant que Madame MICUS, de son prénom Nobuko, frappe les pierres (des cubes lamellés) sur les plages 3 et 6. L’ensemble trop austère et trop froid nous fait regretter la chaleur organique de Ocean et de Twilight Fields.
Darkness and Light (1990-ECM)
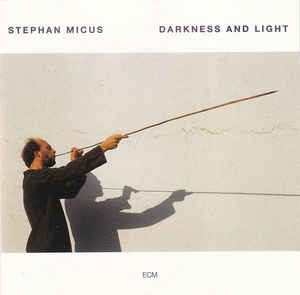 On peut considérer The Music of Stones comme un intermède, un intervalle étrange dans une discographie à la qualité régulièrement ascendante. Et par un simple effet mécanique de la dynamique mise en marche quinze ans plus tôt, on peut aisément prédire que Darkness and Light sera meilleur que le précédent, c’est-à-dire l’excellent Twilight Fields (The Music of Stones comptant pour un éventuel faux pas). Et c’est ce qui arrive.
On peut considérer The Music of Stones comme un intermède, un intervalle étrange dans une discographie à la qualité régulièrement ascendante. Et par un simple effet mécanique de la dynamique mise en marche quinze ans plus tôt, on peut aisément prédire que Darkness and Light sera meilleur que le précédent, c’est-à-dire l’excellent Twilight Fields (The Music of Stones comptant pour un éventuel faux pas). Et c’est ce qui arrive.
Darkness and Light est excellentissime ! La crème de la crème de sa discographie ! L’album est le plus expressif, le plus profond et le plus beau d’une série déjà fournie en perles. Ici le meilleur se croise : Till the End of Time rencontre East of the Night (Stephan a ressorti sa guitare et son kortholt). Ce croisement est de plus fécondé et bonifié par la présence d’un suling magique. Le dilruba ici nous arrache des larmes. East of the Night avait été pressenti comme l’album final de guitare au-delà duquel on ne pouvait ajouter que des propos superfétatoires. Eh ! bien non ! Darkness and Light délivre une grâce plus profonde encore, s’il est possible, et ce à notre plus grande joie.
Darkness and Light Part I constituera une frontière, une limite qui ne sera jamais dépassée par la suite. Cette suite de trente minutes s’écoute en boucle. Sur la pochette, on voit Stephan MICUS jouer du « ki un ki » (mais où va-t-il donc chercher ces instruments ?), qui est un long tube de bois mince et creux qui par inhalation de l’air et modulation de celui-ci dans la gorge, possède le timbre d’une trompette. Ce ki un ki, d’origine sibérienne, fonde avec les dilrubas la trame du deuxième titre, à la consonance assez inusitée pour MICUS puisque quasiment jazz.
Le final à son début nous propulse dans un spectre sonore aux antipodes des aigus un peu rauques du ki un ki puisqu’il donne la part belle à des ballast-strings (des tuyaux de bronze d’un mètre de long suspendus à un daf) et à des gongs balinais qui œuvrent dans les graves. Les dilrubas ont ici un timbre funéraire. Il faudra attendre l’irruption du suling pour contrebalancer le poids d’une ambiance rien moins que funeste.
Après Darkness and Light, Stephan MICUS ne pourra que déchoir, tout au plus se maintenir grâce à des coups d’éclats.
To the Evening Child (1992-ECM)
 Après l’apogée de Darkness and Light, Stephan MICUS cristallisera définitivement son style entre médiévalisme hiératique, africanitude sereine et orientalisme feutré. L’Afrique, nouvelle influence, rentrera à pas de loup, avec certaines intonations vocales de ce superbe To the Evening Child, ainsi que par l’emploi quasi-systématique du steel-drum tout au long de cet album ultra-représentatif du style MICUS.
Après l’apogée de Darkness and Light, Stephan MICUS cristallisera définitivement son style entre médiévalisme hiératique, africanitude sereine et orientalisme feutré. L’Afrique, nouvelle influence, rentrera à pas de loup, avec certaines intonations vocales de ce superbe To the Evening Child, ainsi que par l’emploi quasi-systématique du steel-drum tout au long de cet album ultra-représentatif du style MICUS.
Le steel drum, à la base un couvercle de bidon renversé et dont la surface est divisée en portions accordées sur une gamme, est une percussion des Caraïbes, s’adressant à l’origine à une population démunie. Stephan MICUS lui donne ici des airs de mystère, alors que cette percussion est plutôt jouée en fanfare, ainsi que des airs de noblesse, alors qu’elle s’adresse d’habitude au peuple. C’est dire qu’on ne reconnaît pas l’instrument ou du moins pas sa couleur caraïbéenne.
C’est donc pour cette raison que la seule trace d’africanitude sera celle des intonations vocales de la choucroute micusienne, qui sur cet album (halleluia !) s’avère tout à fait digeste. Cette fascination pour l’Afrique trouvera son apogée dans The Garden of Mirrors. Dans To the Evening Child, de nombreux instruments de son génial prédécesseur Darkness and Light sont repris, entre autres les ballast-strings, le dilruba et le tin whistle. La présence des percussions métalliques (ballast-strings et steel drums) utilisés à la MICUS, donne à l’album un côté temple javano-cosmico-birman, sans qu’on échappe ici à l’inévitable ambiance médiévale (Young Moon) ou classisante (Yuko’s Eyes).
Par ailleurs, l’Afrique n’est pas seule invoquée dans ce brillant essai, car dans les mélopées on croirait souvent entendre des pointes d’hébreu. Bref, To the Evening Child constitue l’opus idéal pour une introduction à l’œuvre de Stephan MICUS ; une œuvre sans faille qui, n’ayant pas le côté déchirant de ses précédents chef-d’œuvres (Darkness and Light ou Till the End of Time), s’écoute d’autant plus facilement. Les titres sont tous de durée modérée, aucun ne dépassant les quinze minutes, ce qui donne au tout une sensation de diversité dans la continuité.
À partir de 1992, l’influence japonaise sera de plus en plus mince ; quant à la guitare elle est ici totalement absente sans que le style de l’artiste en soit modifié.
Athos (1994-ECM)
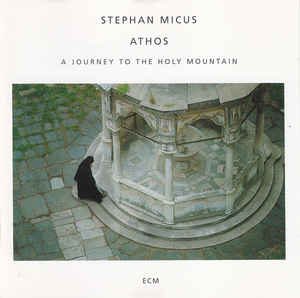 Athos, qui relate un séjour de trois jours de l’artiste sur cette montagne grecque dédiée à l’érémitisme, est semble-t-il l’un des albums qui s’est le plus vendu de Stephan MICUS. À l’acmé de la vague new-age (qui s’éteindra à la fin des 90’s), l’album avait alors tout pour séduire les fans d’ERA, d’ADIEMUS et autres ENIGMA, le silence et l’introspection en plus, la batterie en moins. Quand MICUS fait presque de la musique médiévale ça passe, quand il fait presque de la musique japonaise ça passe, mais quand il fait presque du grégorien… ça casse ! Et là tout le côté allemand, un peu (franchement) lourd se découvre.
Athos, qui relate un séjour de trois jours de l’artiste sur cette montagne grecque dédiée à l’érémitisme, est semble-t-il l’un des albums qui s’est le plus vendu de Stephan MICUS. À l’acmé de la vague new-age (qui s’éteindra à la fin des 90’s), l’album avait alors tout pour séduire les fans d’ERA, d’ADIEMUS et autres ENIGMA, le silence et l’introspection en plus, la batterie en moins. Quand MICUS fait presque de la musique médiévale ça passe, quand il fait presque de la musique japonaise ça passe, mais quand il fait presque du grégorien… ça casse ! Et là tout le côté allemand, un peu (franchement) lourd se découvre.
Formellement, la musique n’a pas changé, toujours autant de silence et autant d’introspection soutiennent cet album. Mais la componction (toutes les parties chantées) et le pathos (toutes les parties au sattar, un instrument à archet ouigour) rendent Athos indigeste. Le seul titre qui nous fait retrouver un peu de la grâce simple et légère de Twilight Fields (The Second Day) est joué au suling et au pot de fleurs. Ce titre à la tonalité franchement asiatique, même si la mélodie est grégorienne, est hélas le plus court de l’album (3’32 minutes). Les deux soli de flûtes (un au shakuhachi et un autre au ney) sont approximatifs dans leur structure et ne retiennent pas l’attention.
Maigre consolation, la pochette tout en blanc est superbe, inspirant d’emblée le recueillement et le sacré, qui ne rattrape hélas pas la grandiloquence du propos musical.
The Garden of Mirrors (1997-ECM)
 Cet album fait revenir notre artiste vers des horizons extra-occidentaux, l’Afrique en l’occurrence ; et c’est tant mieux, car la sphère occidentale a tendance à faire vibrer en lui une fibre pathétique parfois pour le meilleur, mais hélas souvent pour le pire (les amateurs d’Athos évidemment me contrediront). Difficile challenge pour un musicien épris d’introspection. L’Afrique n’est pas le Japon, terre naturelle d’une âme amoureuse de silence et de délicatesse.
Cet album fait revenir notre artiste vers des horizons extra-occidentaux, l’Afrique en l’occurrence ; et c’est tant mieux, car la sphère occidentale a tendance à faire vibrer en lui une fibre pathétique parfois pour le meilleur, mais hélas souvent pour le pire (les amateurs d’Athos évidemment me contrediront). Difficile challenge pour un musicien épris d’introspection. L’Afrique n’est pas le Japon, terre naturelle d’une âme amoureuse de silence et de délicatesse.
Néanmoins, le pari est amplement gagné et ce grâce au choix des instruments, principalement des harpes africaines (le bolombatto, une harpe à quatre cordes en boyaux, et le sinding, une harpe à cinq cordes en coton), qui résonnent comme des contrebasses. Et c’est dans une atmosphère plus ouatée qu’à l’accoutumée que viennent aux oreilles de l’auditeur les instruments habituels de Stephan MICUS (le shakuhachi, le nay, le tin whistle).
Les seuls instruments percussifs sont le steel drum (qui, joué de façon feutrée, ajoute une touche ouatée au son) et des percussions dans Gates of Fire (titre à caractère de légère attente fébrile). Bref, pas un gramme de djembé ou de doundoun. On s’en doutait, Stephan MICUS n’est pas GUEM, et Twilight Fields reste son album le plus rythmé. Dommage, car les parties rythmiques dans sa discographie sont souvent excellentes.
Néanmoins, cette Afrique zen est loin d’être déplaisante ou ridicule. La grâce y est présente (Night Circles, avec ses chœurs simili sud-africains, est l’un des plus beaux titres de MICUS) et l’album est l’un de ses tout meilleurs (en mettant Till the End of Time et Darkness and Light de côté). La choucroute africanisante qu’il applique à ses vocaux est sauvée du ridicule par la présence justement de cette grâce, et l’homme se décide à redonner enfin de vrais titres à ses morceaux. On note un final (Words of Truth) aux accents chrétiens, un christianisme apaisé qui n’est pas sans rappeler, mutatis mutandis, l’atmosphère du final de Passion, de Peter GABRIEL.
Jouée sur six shakuhachi, cette tombée de rideau est particulièrement évocatrice d’un crépuscule dans la cour d’un monastère. Ah ! que j’eusse aimé qu’Athos délaissant ses accents mariaux nous régalât d’une musique aussi suave !…
Desert Poems (2001-ECM)
 Continuant dans l’exploration de l’Afrique (d’évidence une Afrique sub-saharienne où l’avancée du désert accueille à bras ouverts les esprits méditatifs), Stephan MICUS décide pour une fois de ne pas innover. En gros, il réédite ici The Garden of Mirrors avec toutefois un peu moins de réussite, malgré un superbe Adela où 22 dilrubas s’y entendent pour sonner comme un orchestre de violons occidental. Pathétique, mais dans une juste mesure, ce titre représente l’élément européen et classique de l’album, avec Shen Khar Venakhi (joué au dilruba et au sattar, instrument archété ouigour).
Continuant dans l’exploration de l’Afrique (d’évidence une Afrique sub-saharienne où l’avancée du désert accueille à bras ouverts les esprits méditatifs), Stephan MICUS décide pour une fois de ne pas innover. En gros, il réédite ici The Garden of Mirrors avec toutefois un peu moins de réussite, malgré un superbe Adela où 22 dilrubas s’y entendent pour sonner comme un orchestre de violons occidental. Pathétique, mais dans une juste mesure, ce titre représente l’élément européen et classique de l’album, avec Shen Khar Venakhi (joué au dilruba et au sattar, instrument archété ouigour).
Les autres titres introduisent le doussn’gouni, une harpe à six cordes en nylon ou en boyau, le kalimba, et reprend le sinding et le steel-drum ouatés de l’album précédent, pour des titres aux atmosphères très méditatives. Le point faible habituel, qui était bizarrement le point fort de The Garden of Mirrors, sont les vocaux. Passablement écoutables dans le titre d’introduction (The Horse of Nizami), ils sont ridicules dans Mikhail’s Dream (et sa choucroute africanisante qui frise l’insupportable), bouffis de prétention dans Contessa Entellina, et réussissent à rendre le titre final, une perle, For Yuko, tout juste écoutable (n’est pas chanteur de Nô qui veut). L’atmosphère des pots de fleurs frappés sonnant comme des gongs, mélangés au shakuhachi, y est pourtant saisissante… sans les voix. On voit que le premier titre contient du doundoun (le talking drum ghanéen dont le timbre peut être modulé par une pression de l’aisselle), mais on ne l’entend guère.
À l’écoute de cet album, les deux bonnes idées que l’auditeur espère pour les albums suivants sont : que l’artiste se coupe les cordes vocales ; qu’il se mette enfin à taper, audiblement, sur une percussion.
Towards the Wind (2002-ECM)
 Sur les deux premiers points de la chronique de Desert Poems, il semble qu’un ange ait réussi à faire entendre raison à notre artiste : Towards the Wind ne contient qu’un titre avec des vocalises pseudo-africaines qui gâchent à peine, par leur aspect emprunté et artificiel, une superbe pièce de guitare « pat-methenienne » (Eastern Princess). Sur le front des percus, Stephan MICUS se décide enfin à frapper, et c’est le superbe Flying Horses porté par douze talking drums au galop qui vient ravir notre oreille et notre corps. C’est assurément la plus grande réussite de Towards the Wind et l’un des meilleurs titres de l’artiste.
Sur les deux premiers points de la chronique de Desert Poems, il semble qu’un ange ait réussi à faire entendre raison à notre artiste : Towards the Wind ne contient qu’un titre avec des vocalises pseudo-africaines qui gâchent à peine, par leur aspect emprunté et artificiel, une superbe pièce de guitare « pat-methenienne » (Eastern Princess). Sur le front des percus, Stephan MICUS se décide enfin à frapper, et c’est le superbe Flying Horses porté par douze talking drums au galop qui vient ravir notre oreille et notre corps. C’est assurément la plus grande réussite de Towards the Wind et l’un des meilleurs titres de l’artiste.
Sur Birds of Dawn les talking drums sont percutés avec moins d’intensité sur un tempo moyen, mais quand même présents. Le nouvel instrument de cet album, qui n’en fait pas qu’une suite musclée des deux derniers albums africanisants, est le doudouk. Cet instrument à vent, originaire d’Arménie, infléchit la tonalité de cet album vers l’Asie Centrale, et par moment lui donne des reflets plus jazz qu’à l’accoutumée, même si la touche méditative reste présente.
En clôture de l’album, le superbe Crossing Dark Rivers au doudouk, shakuhachi et guitare sonne avec des accents amérindiens. Crépusculaire et introspectif, il aurait dû faire un tabac lors de la vague new-age amérindienne (Peter KATER…), la sincérité en plus. On remarquera également Padre, un morceau de doudouk dédié au père de Stephan, Eduard MICUS, peintre renommé décédé en 2000.
Ce dernier album de Stephan MICUS est en définitive très bon, si on omet le très dispensable Virgen de la Nieve, une pièce jouée à la guitare à quatorze cordes, comble lorsqu’on sait qu’à la base l’artiste est d’abord guitariste, et Eastern Princess (pour les raisons citées plus haut).
Bref, Stephan MICUS se maintient plus que bien et s’il continue à réussir à sortir ses prochains albums en se renouvelant comme il l’a toujours fait (un renouvellement moins risqué toutefois sur les trois derniers opus), il est certain de rencontrer les grâces d’un public qui un jour ou l’autre sera saturé des fureurs ou des inconsistances musicales de ce siècle naissant.
Site: http://www.stephanmicus.com/
Réalisé par Héry
(Article original publié dans
ETHNOTEMPOS n° 15 – septembre 2004)
Lire l’entretien avec Stephan MICUS







